
Sénégal - Bantako, site d'orpaillage ...
Comme je l'écrivais dans ma précédente publication, nous avons, lors de notre séjour dans le Sénégal oriental au mois d’octobre 2013, visité différents sites peu fréquentés par les touristes.
La région de Kédougou comprend plusieurs contrées aurifères comme Tinkoto près de Mako, Sabodola au Nord-Est de Kédougou, et Bantako entre Mako et Kédougou, sur le bord du fleuve Gambie.
C'est ainsi, qu'accompagné de Tapha, notre guide embarqué à Dakar, notre petit convoi de trois véhicules 4X4 s'est présenté à l'entrée du village de Bantaco, afin d'y découvrir son site d'orpaillage.

A Bantako, à 5 km de Tomboronkoto, une trentaine de kilomètres de Kédougou, de 4 000 à 5 000 personnes, venant du Sénégal, mais aussi du Mali, de la Guinée, de la Gambie et d’autres pays de la sous-région, creusent des trous profonds de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, à la recherche de la roche renfermant de la poudre et aussi parfois des pépites d’or.





Paysage aux environs de Bantako


Pistes empruntées pour rejoindre Bantako


Musique de la vidéo : Enio Moricone - Pour une poignée de dollars
Arrêt devant la maison du responsable du villlage afin d'obtenir, moyennant quelques francs CFA, l'autorisation de visiter le site d'orpaillage.
Vidéo de notre arrivée dans Bantako
Un des restaurants de Bantako, que nous ne testerons pas, après avoir survécu aux risques routiers (publication précédente) inutile de se mettre en danger gastronomique... Objectif, éviter "la tourista" et pleinement profiter de notre séjour...





Le précieux "sésame" en poche, c'est accompagnés d'un guide local, que les trois équipages partiront à pied, sous un soleil de plomb, rejoindre le site d'orpaillage.






L’orpaillage reste au cœur des activités économiques et sociales de la région. C’est une activité de survie qui résulte de la paupérisation soutenue de populations confrontées aux difficultés économiques récurrentes. Bien qu’il soit difficile d’établir des statistiques sur cette activité largement informelle et souvent occasionnelle, il est aujourd’hui probable qu’au moins plusieurs milliers de personnes soient directement et régulièrement impliquées dans l’orpaillage qui vit les derniers jours d’une pratique ancienne, vieille de plusieurs siècles.




Les sites ont leurs règles que tout orpailleur accepte d’avance en venant s’y installer. L’accès est ouvert à tous, à condition de se soumettre aux règles édictées.
Caractérisé par des pratiques coutumières, un "Dioura" (exploitation de mines d’or, de métaux précieux…) en Diankhanké langue dérivée du Mandingue, l’orpaillage est d’une rigueur qui frappe impitoyablement tous les délits commis sur les sites. Les interdits sont les suivants : Les rapports sexuels sur les sites, les vols, l’accès des cordonniers aux sites, l’introduction du chien dans les sites en activité, le travail sur les sites les lundis, la présence des forgerons dans le "dioura".
Ces interdits ont une symbolique ancrée dans la conscience collective des populations.
Après l'agriculture, l’orpaillage est la deuxième occupation des populations dans les zones rurales de Kédougou. Pendant la morte saison, l’orpaillage occupe une majorité de personnes autour des "dioura".






Les risques relatifs à l’orpaillage sont souvent liés aux dures conditions de travail et aux accidents sur les sites d’orpaillage.
Les conditions de travail sont souvent à haut risque et très pénibles pour les femmes et les enfants toujours présents dans les aires de traitement. On assiste très souvent à des accidents mortels liés à l’extraction dont les causes sont l’éboulement, l'affaissement de terrain, l'asphyxie, ou l'éruption soudaine d’eau dans les trous. L’exposition aux poussières de roche, aux vibrations, la pollution due à l’utilisation du mercure… sont sources d’accidents et de risques sur les sites.


Les problèmes liés à l’extraction et au traitement de l’or se matérialisent encore aujourd’hui par des méthodes d’extraction et de traitement rudimentaires et des outils très simples tels que des pelles, des piques, des pioches, des seaux, des calebasses et des pièces métalliques diverses.
Les carences techniques sont dues à la fois à l’absence de moyens et au manque d’ouverture culturelle mais aussi à la forte incapacité à surmonter les problèmes et à innover pour aller vers plus de productivité, de rentabilité et surtout de sécurité. Avec un faible revenu journalier, l’orpailleur n’a pas les moyens d’investir dans l’équipement lourd.













Chaque trou, souvent voisin du suivant de quelques dizaines de centimètres, non étayé, est géré par un propriétaire autorisé par un comité désigné par les mineurs. Il recrute des foreurs outillés sommairement par des forgerons locaux artisanaux, de concasseurs et de laveurs.
Contrairement à l’exploitation de type alluvionnaire, celle dite exploitation filonienne est plus libre car ne procédant à aucune forme particulière d’organisation, mais également mieux coordonnée, elle obéit à une réglementation. Elle consiste à délimiter une surface sur le site, et a creuser un trou-mine à dimensions variables, afin de trouver la roche, et de procéder à son exploitation. Seulement, c’est un travail fastidieux qui nécessite beaucoup d’efforts physiques. C’est pourquoi on n'y rencontre pas de femmes.
Cependant, les orpailleurs ne respectent pas la législation limitant la profondeur d’un puits à 10- 15m. La roche ne pouvant pas être localisée de manière aléatoire, certains orpailleurs suivent son cheminement et peuvent atteindre 30 m de profondeur avant de poursuivre le creusement latéral.



A Bantako, l’exploitation alluvienne est également pratiquée. Les monticules de terre aurifère, sont tamisés, afin de séparer les pépites.

Musique de la vidéo : Enio Moricone - Pour une poignée de dollars




La pratique de l’orpaillage est au cœur de toute activité économique et sociale dans les différentes zones d’orpaillage.
C'est une activité presque mythique où l’espoir du gain rapide suscite un engouement populaire et justifie les logiques de survie individuelle et familiale.
Les orpailleurs mandingues, particulièrement les "diakhankés", considéraient donc l’or comme une propriété des génies. L‘offrande était proportionnelle à la quantité d’or trouvée, il pouvait s’agir d’un coq, d’une chèvre ou même d’un bœuf.


Forgeron à l'ouvrage
Pour se donner du courage, les orpailleurs jeunes et adultes, consomment de l’alcool, des amphétamines, des stupéfiants ou inhalent de la colle. C’est ainsi que l’usage des stupéfiants, l’escroquerie, le banditisme et même la criminalité ont tendance à s’y développer. Les vols, les escroqueries et parfois les agressions sont monnaie courante sur les sites d’orpaillage, ce qui explique les récurrentes bagarres souvent ensanglantées. Aucune structure étatique pouvant assurer la protection de la libre circulation des biens et des personnes n’est sur place. Les places communément appelées «dioura» font figure de «no man’s land».
Autour de ces mineurs s’est constitué un village de vendeurs en tout genre. Produits alimentaires, pièces mécaniques, et aussi des trafics de toutes sortes, prostitution etc. Cette mini société s’autogère avec le service d’ordre local, et juges pour les cas de conflits divers.
Les effets néfastes de l’orpaillage ont longtemps été mis en avant par les pouvoirs publics impliqués dans la problématique du développement et la protection de l’environnement. L’exploitation minière artisanale se pratique sur une centaine de sites, procurant ainsi des revenus à des milliers de personnes vivant principalement en milieu rural, mais comporte d’énormes inconvénients notamment sur la santé humaine, l’environnement et les ressources naturelles. Elle contribue également à vider les établissements scolaires de leurs élèves, qui doivent aider leurs parents dans le "dioura", ce qui conduit forcément à une baisse du taux de scolarisation dans les zones d’exploitation.


L’orpaillage dégrade, appauvrit et favorise l’érosion et l’épuisement progressif des sols, mais également la dégradation des forêts et la dissémination de la faune. Le niveau de paupérisation et de précarité justifie souvent l’orpaillage traditionnel, activité de survie malgré les conséquences néfastes pour l’environnement. Cependant, la dégradation de l’environnement favorise également, outre les infections sexuellement transmissibles du fait de la prostitution clandestine, phénomène en constant développement, certaines maladies contractées sur les sites d’orpaillage.











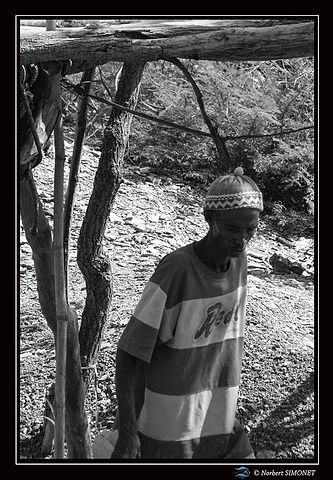







Aujourd’hui, le nombre d’orpailleurs sur les différents sites recensés est estimé à plus de 50 000 personnes.
La conséquence immédiate de l'exploitation des gisements d’or, un peu partout dans cette partie orientale du pays, est outre une augmentation des ressources financières, la disparition du verrou social.
Les «castés» qui occupaient le bas de la hiérarchie sociale ont, grâce à l’argent gagné dans l’or, connu une ascension sociale. Ils ont monté leur propre business (des salons de coiffure, des commerces) et sont même parvenus à recruter. La réussite sociale que leur confère l’or a permis à ces personnes de s’affirmer et d’être des modèles de réussite pour la société.
Mais les conséquences funestes de cette fièvre de l’or sont multiples :
-
l'abandon des champs par les paysans. A court terme, il y a de graves conséquences sur la sécurité alimentaire malgré la richesse monétaire.
-
le retrait des enfants de l'école pour la main d’œuvre. A terme, diminution de la scolarisation et recul important du programme d’alphabétisation.
-
Sur le plan médical, la manipulation à main nue du mercure hautement cancérigène amènera une augmentation de cette pathologie. Le métal est rejeté dans le fleuve et par la chaine alimentaire fluviale empoisonne l’eau, tous les poissons et les consommateurs, de plus, la propriété de ce métal sur le développement embryonnaire provoque déjà à la maternité de Tomboronkoto de nombreuses malformations congénitales, ce mercure étant manipulé par des femmes enceintes.
-
Le développement de la prostitution : ce fléau concerne des femmes de tout âge mais également des jeunes filles mineures des villages environnants ou de l’étranger (Nigériennes). Les conséquences sont une flambée de maladies vénériennes, un taux de prévalence de sida estimé par les autorités sanitaires à 7% alors qu’il est de 1% pour le Sénégal.
-
Le développement important de tous les trafics, y compris drogue et armes et du banditisme.
On peut conclure que, paradoxalement, cet or apporte le malheur dans cette belle région.

Dans une prochaine publication je vous ferai partager une nouvelle étape de notre séjour à l'extrême sud-est du Sénégal, cette fois en altitude, dans le village d'Iwol en pays Bédig...

A suivre ...


